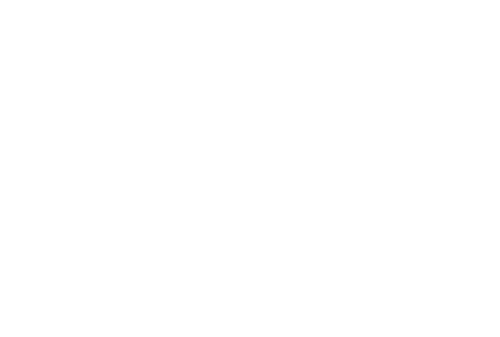Paris 03/12/2009 – Deux ans après avoir tourné la page de Gnawa Diffusion, le groupe avec lequel il a commencé à se faire connaître dans les années 1990, Amazigh Kateb poursuit son aventure musicale sous son nom avec Marchez noir, un album toujours très en lien avec le pays natal de ce chanteur algérien, devenu grenoblois d’adoption.
Paris 03/12/2009 – Deux ans après avoir tourné la page de Gnawa Diffusion, le groupe avec lequel il a commencé à se faire connaître dans les années 1990, Amazigh Kateb poursuit son aventure musicale sous son nom avec Marchez noir, un album toujours très en lien avec le pays natal de ce chanteur algérien, devenu grenoblois d’adoption.
RFI Musique : Avant d’être disponible en France, votre nouvel album Marchez noir est d’abord sorti en Algérie. Est-ce un marché qui a toujours autant compté pour vous ?
Amazigh Kateb : Pendant les dix premières années où j’étais en France, je ne pouvais pas rentrer en Algérie pour une question de service militaire. La première fois qu’on y a joué, c’était en 1999. En fait, les premiers albums de Gnawa Diffusion n’étaient pas distribués là-bas officiellement mais ils circulaient sous le manteau. Ça tournait dans certains milieux, dans les facs… Ça m’a fait du bien de voir ça. Parce qu’à un moment, quand tu écris des choses sur ton pays dans lequel tu n’es pas retourné depuis longtemps, tu te sens en décalage, et tu te dis que ça transparait peut-être dans ta musique.
Ce disque répond-il à une envie de longue date ou l’avez-vous imaginé après la fin de votre aventure avec Gnawa Diffusion ?
Ce n’est pas un enfant accidentel, loin de là. Quand j’étais avec Gnawa, j’avais commencé à écrire certaines chansons de ce disque. Je voulais d’abord faire une pause : quinze ans de route, je n’en pouvais plus. Je me disais que j’avais des titres prêts et que le jour où je serai fauché, je me remettrais à travailler. Et tout est reparti sur les chapeaux de roues parce que l’envie était forte. On l’a fait en huit mois, sachant qu’on était en tournée et qu’on avait peu de temps entre les concerts.
Une tournée avec un répertoire qui n’était pas encore enregistré ?
On l’a toujours fait avec Gnawa. Ce sont deux émotions très différentes. Arriver dans une salle où les gens ne connaissent pas ta musique, ça t’oblige à une gymnastique plus compliquée que si le public connait les paroles. J’aime ça. Quand tu fais un concert, que tu retrouves quinze vidéos sur Youtube et que le lendemain les gens chantent le refrain alors qu’il n’y a pas encore de disque, tu comprends que tu peux faire ton boulot sans matraquage médiatique.
 Musicalement, en quoi cet album vous ressemble-t-il plus que ceux faits avec votre précédent groupe ?
Musicalement, en quoi cet album vous ressemble-t-il plus que ceux faits avec votre précédent groupe ?
Ce son-là, je ne l’avais jamais imaginé. Je ne pensais pas faire un disque avec un DJ mais, en rencontrant Boulaone, il y a eu une vraie complicité humaine et musicale. C’est un mélomane, il balance des sons pour se faire plaisir et reste dans la couleur des morceaux. Du coup, ça me libère. Avec Gnawa, j’avais pris l’habitude d’apporter le minimum pour laisser le plus de libertés aux autres. Ça avait installé chez moi une manière paresseuse d’écrire les chansons, parce qu’à un moment, ça te vexe de bosser jusqu’à 4 heures du matin pour amener des titres complets et de voir que les gars jouent ce qu’ils veulent en répétition ! Refaire un album tout seul m’a obligé à retravailler sur mes morceaux en imaginant à peu près tout.
Pourquoi avoir choisi de donner à votre album un titre qui se lit de différentes façons ?
C’est un album qui a été fait en marchant, sans étude de marché, mais comme un gamin qui n’a pas de jouet et doit le fabriquer. C’est aussi un clin d’œil aux marches noires, comme celle de Martin Luther King. Et dans le manichéisme ambiant, si le noir est la couleur du mal, je la préfère car ça ne m’intéresse pas de faire partie de l’axe du bien, des bien-pensants et bien-mangeants.
En live dans l’émission de Laurence Aloir, Musiques du monde, le vendredi 4 décembre.
« Dans le titre I wanna Tcheefly, il y a le camouflage algérien de l’amour… »
par Amazigh Kateb
« Ce disque est un hommage à toutes les marches noirs de l’histoire »