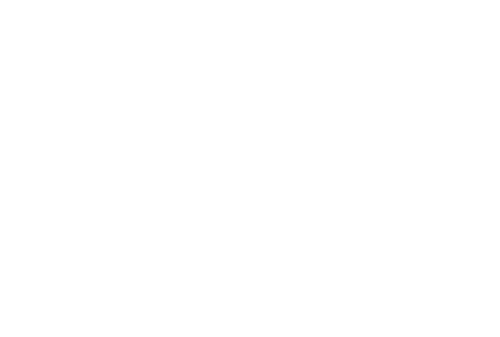La doyenne de la chanson kabyle, Arab Yamina, dite Lla Yamina, s’est éteinte le mois dernier, emportant avec elle, ainsi que Lla Ounassa la plus âgée, l’histoire de la fondation de l’antenne kabyle de Berthezène en 1936. Depuis, d’autres voix les ont remplacées avec orchestration et chansons commercialisées. Le premier trio de l’histoire de la chanson kabyle Lla ounassa, Lla Yamina et Lla Zina ont été éclipsées sans pour autant que leur «acwiq » ait été sauvegardé ni enrichi…
La doyenne de la chanson kabyle, Arab Yamina, dite Lla Yamina, s’est éteinte le mois dernier, emportant avec elle, ainsi que Lla Ounassa la plus âgée, l’histoire de la fondation de l’antenne kabyle de Berthezène en 1936. Depuis, d’autres voix les ont remplacées avec orchestration et chansons commercialisées. Le premier trio de l’histoire de la chanson kabyle Lla ounassa, Lla Yamina et Lla Zina ont été éclipsées sans pour autant que leur «acwiq » ait été sauvegardé ni enrichi…
Lla Yamina, de son vrai nom Arab Yamina est née à Akbou présumée 1905. Orpheline de ses parents, elle est recueillie par sa famille maternelle vivant à Alger où elle débarque en 1924 à l’âge de 19 ans. Au moment où elle quitte Akbou, l’exploitation des mines ferreuses de Gueldamane, au sud, avait attiré nombre de villageois venus travailler et s’installer avec leurs familles aux alentours de la ville. Pour surveiller ce site en pleine expansion, des garnisons militaires y furent dépêchées. Avec elles, s’ouvrirent, les premières maisons closes dans la région.
C’est à cette période, probablement, que le couple Lafarge vint s’installer à Akbou pour quelques années. Armand Pierre Lafarge fut nommé plus tard commandant du 42 ème RT (Régiment de transmission) français. Son épouse fréquentait assidûment les cercles féminins des «ourar» à l’occasion des fêtes familiales. Elle donna son nom à la première antenne radio kabyle, la station de Mme Lafarge, ouverte en 1937 dans les sous sol de la salle Pierre Bordes, l’actuelle Ibn Khaldoun, rue Berthezène. L’année 1937 vit la construction du mur de l’Atlantique réalisé par la firme allemande Todt qui avait grand besoin de main d’œuvre nord Africaine.
La route maritime transméditerranéenne était libre et les officiers recruteurs sillonnaient la Kabylie et recrutaient à tour de bras de jeunes paysans. A quels objectifs répondait cet émetteur de Madame Lafarge inauguré par des voix féminines villageoises? Bien que de diffusion restreinte, il fallait une politique d’encouragement à la population kabyle qui donnait tant aux campagnes militaires françaises et qui était la pépinière du recrutement forcé à la construction du mur de l’Atlantique. L’objectif était politique avant d’être artistique.
Le témoignage de Lla Yamina
Les premières femmes qui donnèrent leurs voix -au sens de violation de leur être vocalique qui s’est toujours exprimé dans des espaces intimes, fermés et intrinsèquement féminins- furent Lla Yamina alias Arab Yamina, Lla Zina et Lla Ounassa, alias Kadim Halima, native du même village que Allaoua Zerrouki, Amalou. Son frère, Kadim Boudjemaâ, non voyant dit Bouhou, virtuose musicien au mandole, était l’ami d’enfance de l’artiste. La famille Kadim donna également dans les années cinquante une militante de la bataille d’Alger, poseuse de bombe. Comment ces femmes ont-elles été approchées par Mme Lafarge? Deux versions de témoignages existent. Hassina Kherdouci dit dans son livre La chanteuse Kabyle qui a rencontré Lla Yamina à la radio d’Alger au début des années quatre vingt dix, «la première femme qui a contribué à former le trio féminin est Lla Yamina, originaire d’Ighil Ali. Orpheline de père et de mère, elle a été prise en charge et élevée par ses oncles maternels à Alger». Les propos recueillis auprès de cette pionnière disent que le recrutement s’est fait à Alger et que Mme Lafarge n’a pas eu à se déplacer à Akbou. Selon les propos de LLa Yamina : «Quand j’étais à Alger chez mon oncle maternel, je sortais à la recherche d’un travail de femme de ménage. Par hasard, je ne sais comment, il y eut Mme Lafarge chez qui travaillait une certaine Yasmine. Elle a demandé à cette dernière si elle ne connaissait pas des femmes qui pourraient venir donner leur voix. Elle répondit par l’affirmative. Khalti Hlima est venue chez moi et m’a tenu informée de la demande. Au départ, j’avais peur. Lla Ounassa me rassura en me disant que personne ne saurait ni nous verrait. Nous finîmes par accepter. Nous partîmes à minuit. C’est Lla Ounassa qui donna la première sa voix au micro…» Vint ensuite Lla Zina. Ce trio fut baptisé «groupe Lla Ounassa» car c’était la plus âgée. Malgré la crainte, la peur et les aléas de la clandestinité vis-à-vis de leurs familles respectives, les trois femmes utilisaient toutes les astuces possibles et imaginables pour rejoindre la station une fois par semaine, les samedi et dimanche dans la nuit. Et cela dura une dizaine d’années, jusqu’à l’ouverture des ELAK (Emissions de langue arabe et kabyle) dans lesquelles elles furent intégrées dans les règles de la professionnalisation artistique. La station de Mme Lafarge n’avait pas de musicien ni d’orchestre. Elle émettait seulement des voix nues dans le genre «acwiq», des litanies festives ou religieuses héritées de la tradition musicale villageoise censées toucher la sensibilité des jeunes hommes en partance pour l’exil. Le trio chantait à tour de rôle, debout, face à un micro suspendu. C’est à l’ouverture de l’AKA que cheikh Noureddine rejoignit le trio ancestral suivi de Amar U Yaâcoub qui se produisait alors dans les cafés avec un chacal ramené du bled. Mme Lafarge, ayant vécu à Akbou et s’étant frotté à la langue kabyle des acwiq intègra elle-même le groupe sous le pseudonyme de Lla Tassadith. Les thèmes changent et les voix ne se cachent plus dans les chants anonymes. Elles osent et chantent leurs conditions individuelles et justifient leur présence à la radio, pourquoi elles ont «donné» leur voix. C’est avec pertinence que Kherdouci rapporte l’analyse de Khedidja Djama, actuellement animatrice-productrice à la l’ENRS chaine II : «Elles étaient dans un tribunal devant un procès juridique, elles sont là les avocates d’elles-mêmes ; plutôt leur chant était leur défenseur devant le juge et le procureur». Le passage de «ourar n lkhalat» à «Nouba Lxalat» est significatif de cette évolution à la fois du rapport de ces femmes à la radio mais aussi de celui qu’elles entretiennent avec leur propre rôle de chanteuse radiophonique. Après 1938 date à laquelle cheikh Noureddine arrive à la radio et constitue un orchestre, d’autres femmes intègrent le groupe comme Ldjida Tamuqrant, Cherifa, Djamila, Zina, Khedoudja et, quelques années après, Hnifa, Ourida, Anissa qui chanteront non plus des acewiq comme leurs aînés mais des chansons orchestrées, exprimant leur propre vécu. La chanson féminine moderne, insufflée par cheikh Noureddine, Mustapha Skandrani et des chefs d’orchestre émérites comme Amari Maâmar, Haroun Rachid et le musicologue Mohamed Iguerbouchène éclipseront les voix fondatrices de la radio kabyle dans la mesure où ces derniers ne se sont guère intéressé à leur chant ancestral.
Le cas Cherifa
L’exemple de Cherifa est, ici, éloquent. Lorsqu’elle a pris le train d’Akbou vers Alger, ce n’était certainement pas pour fuir un village qui lui interdisait de chanter, de sortir des voix dites anonymes, groupales, imposées par une tradition qu’on se plaît à avancer comme source de toutes les interdictions faites aux femmes de transgresser les lois tribales. Le train qui l’emmenait vers la capitale qu’elle ne connaissait pas, où elle n’avait personne, ni même Dieu, était plus qu’un moyen de transport, une histoire, une déchirure. C’était ce train qui ramenait et emmenait également des hommes, eux-mêmes soumis, plus que les femmes, à de dures conditions de survie alimentaire, réduits à une condition infrahumaine.
C’étaient les pauvres mineurs de la montagne ferreuse de Gueldamane qui donnait à Akbou, vers le sud, une touche surréaliste. Nous ne pouvons que comprendre l’exil de Cherifa hors du contexte socio historique qui était le sien. Une étude plus approfondie de cette région montrerait sans nul doute que le cas Cherifa n’est pas isolé. En effet, cette région soumise par la conquête coloniale et exploitée pour ses richesses marines, salifères et ferreuses allaient connaître, à la naissance même de Cherifa, une ouverture sans doute négative pour les autochtones, mais fertile pour les conquérants qui y trouvèrent l’opulence durant la période de l’entre-deux guerres mondiales. Toutes les chanteuses pionnières de l’ancêtre de la RTA, dite Radio Berthezène de Madame Lafarge, sont issues de cette région à la géographie contrastée, partagée, comme Azeffoun qui a donné Hanifa et tant d’autres artistes, hommes ou femmes, entre montagne chauve et mer qui se souvient avoir rejeté sur ses rives les andalous chassés d’Espagne. Il faut rappeler que l’antenne de Madame Lafarge avait été créée pour accompagner les jeunes villageois kabyles recrutés de force, sur les marchés de leur région natale, pour les mines, plus tard, sur les hauts fourneaux de Charenton et les chaînes interminables des premières usines automobiles, comme Renault à Boulogne Billancourt.
Le train qui emmenait Cherifa pour la première fois à Alger était chargé d’histoire. Et la chanson Baqa Aâla khir ay Akbou l’est tout autant. Tout le texte de la chanson est une douloureuse rupture avec le village natal où elle vécut au début des années 1930, une enfance orpheline de bergère, où, comme toutes les filles de son âge, elle était destinée à un sort commun.
Mais, où a-t-elle puisé cette force individuelle pour descendre seule de son village, venir à la gare ferroviaire, prendre, seule, ce train? La question pourrait rester sans réponse si l’on omettait encore une fois le contexte socio historique de cette contrée. Les villages, en cette année du milieu des années 1930, avaient connu, contrairement à ceux de la Kabylie du Djurdjura, un exode féminin d’abord vers les bourgs coloniaux, comme Akbou, Sidi Aïch puis vers les villes portuaires comme Bejaia et Jijel.
Les autorités coloniales qui commençaient l’exploitation des terres salifères de la région d’Imallahan, de la montagne ferreuse de Gueldamane et la construction du port de Bejaia, avaient besoin d’une main d’œuvre… féminine. Ce n’est donc guère étonnant que Cherifa ait pu quitter son village et prendre ce train si présent dans les voix féminines qui se lamentaient suite au départ des hommes au front de la première guerre mondiale.
Il suffit de lire le précieux recueil de Malek Ouary, de la même région que notre chanteuse, pour se rendre compte à quel point cette image du train «tamacit» a marqué le substrat mental et verbal des paysannes de cette région. C’est, tour à tour, dans leurs poèmes, une «machine noire», «tamacit taberkat» qui peine à quitter la gare, «tamacit wahda wahda». Dans la belle voix de la chanteuse Ourida, cette machine est personnifiée car elle est chargée de porter le salut, sous la voix masculine, à la mère à qui cette voix a été brutalement arrachée.
Ne retenir de la naissance de Cherifa dans la chanson, de son passage de la voix groupale, celle des Ourar (fêtes villageoises) à celle de l’individu femme que cette image d’un romanticisme désuet, d’une artiste qui décide de sortir de l’anonymat, consciente d’avoir été brimée dans ce rôle, ne grandirait pas ni Cherifa en tant que femme, ni sa voix en tant qu’esthétique féminine. Elle a pris certes un pseudonyme mais cela n’est pas le propre des chanteuses féminines. Elle a quitté son village, mais combien de femmes et d’hommes ont fui la misère et la famine de leur région pour la capitale prometteuse de pain. Cheikh Noureddine qui a longtemps été le génial musicien de Cherifa a été plus que ne l’aurait été une femme, proscrit de son village de Larbaâ Nath Iraten. La complexité sociologique et la primauté de l’explication historique nous semblent être les paramètres principaux et significatifs pour aborder des phénomènes artistiques aussi importants pour parler d’une voix aussi marquante que celle de Cherifa.
La première brisure de sa voix est d’être sortie, sans être libérée des voix féminines anonymes des Ourar. Le train qui l’a emportée hors de son gynécée naturel, lui a inspiré, pourtant, sur un air ancien, anonyme, un air de dikr ou de berceuse. La classification est ici peu opératoire, s’agissant d’un poème ancré dans les chants anonymes féminins anonymes parce que sans doute l’Etat civil colonial de Napoléon n’était pas encore né ou parce que c’était la seule forme de chant en groupe dans une société rurale où travailler et chanter étaient l’œuvre commune. On oublie souvent que le chant religieux, le dikr, était un chant anonyme, groupal et ce n’est que tardivement que ses promoteurs l’ont médiatisé et qu’il a même donné naissance à la chanson moderne par la voix de Mokrane Agawa et plus tard de Idir.
Cette brisure vocale dans les compositions «instinctives» de Cherifa se manifeste dans ses premières chansons qui sont toutes composées à partir de chants traditionnels en ce sens qu’elle développe des thématiques d’un terroir confronté à l’esseulement des femmes, à la migration des hommes, à la famine, au désarroi collectif. Comment, sinon, expliquer qu’aucune chanson de Cherifa ne réfère à Alger, à la capitale où elle a vécue un exil physique et intérieur, où elle a connu avec Hanifa, une autre voix écorchée vive, qui, elle, a été plus en avance que celle de Cherifa car certainement plus jeune, la misère des bidonvilles des hauteurs d’Alger.
Cette brisure vocale est restée entièrement nostalgique des chants anciens, ceux qui ont bercé son enfance et rempli sa voix des Ourar. Ay azerzur, yelsa d tacacit, ezid a yemma anruh, a tawaghit et tant d’autres, jusqu’à ses plus récentes chansons exclusivement destinées aux circonstances festives, en attestant la véracité. La voix de Cherifa, même en accédant à son statut de «voix médiane» est restée dans le giron des voix groupales en matière de création.
Mais est-ce véritablement de la création quand on sait que Cherifa, n’écrit ni ne se fait écrire ses textes encore moins ses airs. Cherifa symbolise la complexité de la parenté entre l’oralité primitive des chants composés dans leur milieu naturel et ceux diffusés par la radio à travers sa voix et une orchestration qu’elle n’avait pas. Cette orchestration est elle-même rudimentaire, aux contours harmoniques incertains. Réécouter aujourd’hui les premières chansons de Cherifa suffit pour un mélomane averti à relever toutes les imperfections de l’orchestration même si, avec le temps et les mythes qui s’y greffent, l’auditeur prend un réel plaisir à les réécouter. Cette brisure vocale que nous pouvons qualifier d’«ombilicale» en relation douloureuse avec le village natal est sans doute la plus marquante dans la vie artistique de Cherifa qui ne s’est pas remise de ce voyage initiatique de la douleur qu’elle fit, un jour, par train.
La deuxième brisure relève de l’artistique, de la relation importante entre ses chansons enregistrées à la radio et sur le disque 45 T avec les chefs d’orchestre outillés de son temps comme Iguerbouchene, Haroun Rachid, Amari Maâmar, Boudjemia Merzak. Cette question est d’autant plus importante qu’elle touche à la jonction jamais réalisée en Algérie entre le folklore au sens positif et nourricier du terme et la musique savante, universelle.
Cette sujétion a son histoire. Contrairement au milieu artistique des pays de l’Orient, -où l’artiste femme «élevée» par de grands compositeurs et paroliers de renom se voit formée et propulsée sur la scène artistique et cinématographique à l’exemple de Oum Keltoum en Egypte-, la chanteuse algérienne n’a pas bénéficié d’une formation ni été encouragée à développer ses capacités vocales dans les formes musicales de leur époque. Après plus d’un demi siècle de carrière, aucun chef d’orchestre parmi les plus en vue de la période de la post indépendance ne s’est intéressé à elle pour, à partir des airs folkloriques repris de mémoire, si poignants comme Baqa ala khir ay Akbou, enrichir sa voix (et sa voie) dans un ensemble orchestral moderne à la hauteur de ses capacités artistiques.
Elle est restée invariablement, tout au long de sa carrière, dans un orchestre rudimentaire aux lignes mélodiques incertaines au point où le genre folklorique de ses compositions s’est lui même dégradé faute d’être pris au sérieux par des chefs d’orchestre soucieux d’universaliser les lignes mélodiques des airs traditionnels féminins ainsi que le firent leurs collègues espagnols pour une Maria Rodriguez.
Les pionnières, comme La Ounassa , LLa Yamina, Djida l’aînée, n’ont pas connu meilleur sort. A défaut d’une véritable formation même sur le tas, ces chanteuses n’ont été que des mythes créés de toutes pièces autour de leur passage dans le monde de la chanson et duquel n’ont été retenues que de pauvres biographies et une foultitude d’anecdotes sans lien aucun avec leur répertoire. Les chefs d’orchestre outillés et qui auraient pu permettre à ces chanteuses un essor artistique ou du moins une interprétation plus étoffée et intelligente de leurs propres chansons ne s’y sont pas intéressé, considérant alors le folklore de ces voix féminines comme un genre mineur, inapte à intégrer la musique universelle et ses instruments musicaux.
Pourtant, Cherifa n’a rien à envier à une Maria Rodriguez ni Hanifa à Edith Piaf puisque cette comparaison est toujours faite d’une manière tout à fait hasardeuse, comme si la notoriété d’une Piaf était nécessaire pour excuser celle que n’a pas eu Chérifa ou Hanifa hors des frontières de leurs pas et souvent même hors des frontières linguistiques de leur propre région. De cette deuxième brisure, Cherifa a sans doute le plus souffert. Si elle a apporté sa voix à la radio, la radio ne lui a pas apporté l’outillage musical qui aurait fait d’elle une voix comme celles de Rodriguez.
Les chefs d’orchestres et maestros de son temps se sont contentés de composer des musiques savantes, d’en imiter les motifs sans chercher à apporter leur savoir à l’enrichissement du folklore kabyle porté par les voix féminines. Iguerbouchene aurait pu faire de Cherifa une cantatrice d’envergure internationale comme l’a fait le génial Maïakovski pour le folklore russe intégré à la musique savante. Pourquoi Maria Rodriguez est-elle sortie des frontières portugaises pour conquérir le monde? C’est que les maestros de son pays ont été à ses côtés, ont compris la richesse du folklore portugais et ont enrichi sa voix en l’intégrant hors des spécificités du terroir ou territoriales. Cherifa s’est démenée seule au point où elle a renoué, d’une manière déguisée, avec le chant groupal qui n’a pas besoin d’orchestration: l’émission «Nouba n lxalat», durant de longues années, avec la célèbre Fatma Zohra qui avait connu d’autres expériences artistiques à Paris avec Cheikh El Hasnaoui dans le milieu dansant des cabarets orientaux de Paris.
Aujourd’hui, Cherifa reste la voix emblématique de la chanson kabyle, plus que celle de Lla Yamina. Mais elle est restée coincée entre l’oralité primitive et la variété moderne. Sa voix mate, aussi piquante que l’ortie, a bercé des générations d’auditeurs de la chaîne II. Mais cela suffit-il pour la création et la création d’un genre? Suffit-il aussi pour s’en complaire? Cherifa est l’exemple même de la sujétion vocale et esthétique de son chant à la tradition villageoise.
Pourquoi faire d’elle alors la chanteuse engagée qui a rompu les amarres avec sa famille, sa géographie, son village alors qu’elle n’a pas cessé d’exprimer par ses chansons la vive nostalgie du paradis perdu, un paradis, certes qui ne nourrit pas, rempli de brimades, mais en tout cas plus riche et fertile en inspiration que cet Alger où elle a vécu un double déchirement: celui de la solitude en tant que femme mais aussi en tant qu’artiste dont le statut lui a été refusé au plus fort de sa célébrité radiophonique.
Les belles chanteuses de l’immigration
Parmi les chanteuses venues à Alger dans leur adolescence comme Lla Yamina, peu d’entre elles se risqueront à prendre le bateau pour la métropole comme l’ont fait Fatma Zohra, Bahia Farrah et Aït Farida. Fatma Zohra est de la même génération que Lla Yamina. Elle est née en 1906 à El-Biar. Elle est décédée à l’âge de 94 ans à Alger. Elle est la célèbre créatrice de quelques chansons éternelles: Axelxal ajdid / A nnagh a Muhend a mmi et d’autres encore que plusieurs générations d’artistes reprennent depuis le début des années 1940. Fatma Zohra a dansé et chanté dans le milieu musical de l’émigration algérienne de France des années 1940 et 1950. Elle a fait des tournées dans les cafés d’émigrés avec cheikh El-Hasnaoui, Kadour Cherchali, Mohamed El-Kamal, Slimane Azem avec lequel elle a chanté en duo Nekk akw d kem (Moi et toi). Jusqu’à la fin de sa vie, elle a été la co animatrice, avec la célèbre chanteuse Chérifa, de l’émission quotidienne consacrée au chant féminin, Nuba Lxalat à l’ENRS – CH II.
Bahia Farah (1936-1984), native de Bouira, émigre à 14 ans à Paris. Elle débute dans la danse orientale dans le 5ème arrondissement et devient l’idole des travailleurs émigrés. Sollicitée par le célèbre compositeur tunisien Mohamed Jamoussi, elle fait partie de la troupe maghrébine et fait plusieurs tournées. Elle chante en duo avec Slimane Azem Attas i sebragh et compose elle-même ses chansons si lebhar ar din, l-mektub ik ak i dyas, sber kan, chansons reprises par Brahim Mesbahi. Elle épouse le miniaturiste Mohamed Temam, lui-même violoniste dans l’orchestre de Missoum. Le couple rentre en Algérie le 1er février 1965. Son époux est nommé directeur du musée Le Bardo alors qu’elle est engagée à la RTA qu’elle ne tarde pas à quitter pour animer des fêtes familiales algéroises. Elle s’éteint le 1er avril 1984.
Choristes, danseuses de cabaret, chanteuses, ces artistes émigrées, sous la férule de Amraoui Missoum, connaissent les feux de la rampe et le vedettariat mais elles n’ont pas oublié le gynécée vocal du trio de Berthezène.
Lla Yamina a pris sa retraite en 1992 et s’est éteinte à Alger le mois dernier, quelques mois après le décès du chanteur Medjahed Mohamed, dans le plus complet anonymat.
Par Hachemi Aït Mansour
Passerelles. Avril 2008
http://passerellesdz.com/articles/mus2.html
Chanson féminine kabyle De Lla Yamina à Ourida: les mêmes brisures vocales
Published: