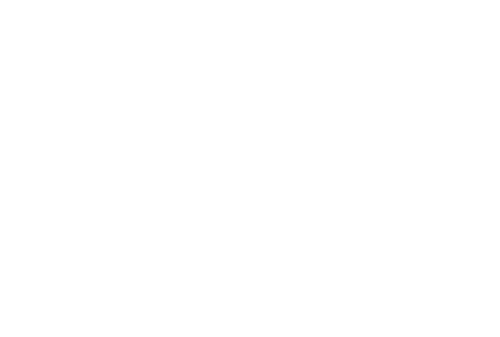Hocine Boukella. Compositeur, leader de Sidi Bemol.
Hocine Boukella. Compositeur, leader de Sidi Bemol.
Essayer de définir Cheikh Sidi Bémol, Hocine Boukella pour l’état civil, relève de l’impossible. Inclassable, imprévisible, l’ancien biologiste n’arrête pas de dynamiter le carcan musical, à la recherche de la juste note, d’un son nouveau. Rencontre avec un artiste atypique en quête de territoires nouveaux.
-D’où vient votre pseudonyme ?
Il fallait trouver un nom de scène. Un soir, je regardais une bouteille de Sidi Brahim et j’ai trouvé que le nom et l’étiquette étaient vraiment jolis. Et j’ai pensé : «Pourquoi pas Sidi Bémol ?». Puis, j’ai pensé que Cheikh Sidi Bémol, c’est encore mieux, ça rappelle un personnage sérieux et en même temps le bémol permet toutes les fantaisies. C’est comme ça que je suis né, en contemplant une bouteille de vin…
-Votre parcours est très original, vous êtes venu en France pour faire des études…
J’ai toujours pratiqué la musique et le dessin, mais je ne voyais pas comment gagner ma vie avec ça. Par contre je voulais devenir biologiste. J’étais passionné par Darwin et la théorie de l’évolution. J’ai fait Bab Ezzouar. Quatre ans. J’étais deuxième de ma promotion, j’ai eu une bourse d’études en France. Mais j’avais des problèmes avec l’administration de l’université qui avait perdu mon dossier et qui refusait de me remettre mon diplôme. Il a fallu la mobilisation de tous mes profs et de la directrice de l’institut de biologie pour que je puisse m’inscrire à l’université de Paris 7. J’ai fait un DEA de génétique et une année de doctorat. Ma bourse a été suspendue et mon contrat avec le ministère de l’Enseignement supérieur a été résilié. C’était la crise déjà et beaucoup d’étudiants algériens ont dû arrêter leurs études à l’époque, car le prix du pétrole était au plus bas. Plus de budget, plus de bourse, pas de diplôme algérien, pas de dossier universitaire, j’étais dans une impasse. Ensuite, il y a eu le grand chamboulement de 1988. J’ai décidé d’abandonner la biologie pour devenir dessinateur et musicien professionnel. C’était un pari osé, car, au début, j’ai surtout travaillé comme peintre en bâtiment. Il a bien fallu dix ans pour que j’enregistre mon premier album.
-Quel est votre rapport à l’Algérie ?
Drôle de question, c’est mon pays ! Je vis en France depuis plus de vingt-cinq ans, mais ça ne change rien à l’affaire. Ma vie est rythmée par les nouvelles qui m’arrivent d’Algérie. Musique, cinéma, politique ; je suis branché sur tout ce qui se passe en Algérie. Tous les matins, je me rue sur la presse algérienne pour me tenir au courant.
-Vous allez devenir schizophrène ! Votre corps à Paris, votre esprit à Alger…
Je ne crois pas que ce soit une maladie. C’est l’Algérie qui a formaté mon disque dur. Je pense que ça n’a rien d’extraordinaire, tous les Algériens expatriés vous diront la même chose. On ne peut pas oublier le pays de l’enfance et de l’adolescence. On ne peut pas oublier nos premiers pas dans la vie.
-Votre musique est un mélange de rock, blues, gnawa, chaâbi,… la liste est longue.
Aziz Smati a écrit que ma musique, c’est du gourbi-rock, ça me va très bien. Le gourbi est composé de matériaux épars, hétéroclites, détournés de leur destination originale. Il est censé être une habitation provisoire, mais il voit défiler des générations de locataires. De plus, le gourbi est un habitat typique de l’Afrique du Nord. Le gourbi décrit bien ma musique. On peut y trouver du rock, du blues, du celte, du jazz, mais c’est avant tout de la musique algérienne.
-Vous chantez en arabe et en kabyle…
Je suis né et j’ai grandi à Alger. A la maison, on parlait kabyle, dans la rue, on parlait arabe et à l’école, on parlait français. Avec mes parents, je parle kabyle, avec mes frères et sœurs je parle surtout en arabe. Je passe d’une langue à l’autre presque inconsciemment. Même quand je réfléchis, j’utilise les trois langues. Mes premiers «concerts», c’étaient les fêtes de mariage du côté de Bouzeguène. On chantait des morceaux traditionnels de la région. Plus tard, je me suis rendu compte que je savais écrire le français et l’arabe, mais pas le kabyle. Je voulais écrire des chansons en kabyle, mais je n’avais pas les outils nécessaires. J’ai pris des cours à l’Association culturelle berbère de Ménilmontant pour commencer, puis j’ai continué tout seul avec des livres.
-Votre installation en France a été facile ?
J’ai eu beaucoup de problèmes au moment où j’ai abandonné les études. Je travaillais comme illustrateur et je faisais pas mal d’expositions. Je me suis présenté à la préfecture de Paris pour changer de statut, c’est-à-dire pour demander une carte de séjour normale, une carte d’émigré en quelque sorte, car les étudiants ont une carte un peu spéciale qui les empêche de travailler à plein temps. C’est là que les ennuis ont commencé. Je me suis retrouvé clandestin du jour au lendemain. Là, ce n’était pas de la tarte. Je n’ai jamais été aussi propre, toujours bien rasé, bien habillé pour éviter les contrôles d’identité. Un jour, je présentais une exposition de dessins et de caricatures à Paris et le ministre de la Justice de l’époque, Jacques Toubon, était venu. Il a acheté des dessins, il m’a dit qu’il aimait bien mon travail. Je lui ai exposé mon problème de papiers et c’est comme ça que j’ai commencé à être régularisé.
-Et depuis, vous boudez l’Algérie, vous donnez peu de concerts, le public algérien est en manque de Cheikh !
Chanter en Algérie, je ne demande que ça. J’ai bien conscience que mon public est surtout en Algérie. Je garde de très beaux souvenirs de mes concerts là-bas, à Alger, à Tizi Ouzou, Béjaïa… Je suis en manque du public algérien. Je suis prêt à débarquer demain si des producteurs sérieux organisent une tournée.
Rémi Yacine
El Watan 27.01.12
Hocine Boukella. "Je suis en manque du public algérien"
Published: