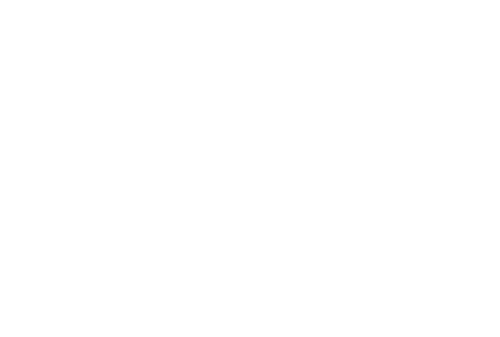Évocation. Marguerite-Taos Amrouche
Surgie des siècles
Dernier maillon d’une chaîne d’aèdes, Marguerite-Taos Amrouche, cantatrice et romancière d’expression française, nous revient cette semaine. Trente-trois années se sont écoulées depuis son enterrement, le 2 avril 1976, dans le village provençal de Saint-Michel-l’Observatoire. Son charisme inaltérable, sa présence irradiante, sa voix chevrotante, n’ont pas pris une ride.
Célébrée et reconnue dans l’autre rive, même après sa disparition, elle n’a pas reçu ses lauriers en Algérie. Née en Tunisie, le 4 mars 1913, la petite Marie-Louise Taos, de son nom d’état civil, grandit partagée entre le souvenir d’un pays abandonné par ses parents et la dure réalité de la terre d’accueil, pas forcement accueillante. Véritable héritière, elle descend d’une lignée de récitants de la tradition orale kabyle, les « clairchants ». Fille de Marguerite Fadhma Ath Mansosur Amrouche, auteur du poignant livre Histoire de ma vie et petite fille de Aïni Aïth Lâarbi-ou-Saïd, Taos tenait de ses aïeux un don céleste : celui de nous faire parvenir des émotions déchirantes, des souffles fragiles, des cotes et des proverbes d’une culture plusieurs fois millénaire. Berbère, chrétienne et française, Taos Amrouche n’en revendique pas moins son algérianité. Elle était cet « hybride » voulant concilier des univers différents et complexes : Croissant et Croix, France et Algérie, modernité et tradition. Un sentier cahoteux qu’elle n’a pas hésité a emprunter, en assumant pleinement sa complexité, sans renier un iota de ses origines berbères. Il semble que la fille tient ce legs de son père, Belkacem Antoine Amrouche, originaire d’Ighil Ali, en basse Kabylie. « C’est un homme extraordinaire, qui a tenté toute sa vie de concilier sa foi et ses origines », révélait Taos Amrouche a propos de son vava (père). Les interrogations douloureuses soulevées par l’auteur de Rue des Tambourins, son frère, Jean El Mouhoub Amrouche, intellectuel aux multiples talents, restent d’une brûlante actualité. Elles sont aujourd’hui la dîme à payer de tous les transplantés. Forcés à l’état végétatif de transplantés, indépendamment de leurs choix, les Amrouche ont trouvé l’ exutoire dans le chant et l’écriture en rendant compte de la complexité et de la douleur d’être des déracinés. « Le sort des Amrouche aura été une fuite harcelée, hallucinante, de logis en logis, de havre jamais, de grâce en asile toujours précaire. Ils sont toujours, chez les autres, étrangers, où qu’ils soient », disait le défunt Mouloud Mammeri.
La révélation
Marguerite Taos Amrouche s’est appliquée durant toute sa vie à la collecte d’un florilège de trésors poétiques auprès de sa mère, Fadhma Ath Mansour. « Pour ma part, ayant baigné depuis l’enfance dans ce merveilleux climat de ses chants et de ses poèmes, le miracle était que je puisse prendre assez de recul pour en découvrir toute la force magique et la beauté : c’est la grâce qui me fut accordée et qui me permit de recueillir des lèvres de ma mère, avec la docilité totale et le respect de l’élève en face du maître, ces chants dont la lumière chemine vers nous depuis des millénaires », avait-elle confié dans les notes imprimées sur le disque Chants berbères de la meule et du berceau », publié en 1975. Voici ce que disait sa fille, Laurence Bourdil-Amrouche, dans un témoignage posthume, également poignant, publié sur la revue Algérie- Littératures/Actions (n° 179-1996), à propos de cette « mission » : « Elle avait une vingtaine d’années, c’est elle qui me l’a racontée. Il était deux-trois heures de l’après-midi. Elle faisait la sieste ; elle était dans cette sorte de demi-sommeil, entre deux eaux, où l’on dit que les rêves sont très importants. Jean était en train de donner un cours dans la pièce à côté. Tout à coup, elle a entendu, dit-elle, une voix chanter en elle. Dans une demi-conscience, elle a essayé de chanter en même temps que la voix. Elle s’apercevait du décalage énorme qu’il y avait entre son chant et cette voix… Soudain, de l’autre côté de la cloison, son frère s’est mis lui aussi, à chanter ce même chant, lointain, plus lointain encore que la voix. Tous les trois, l’être invisible, elle et Jean, chantaient à l’unisson (…) Sa mission était là : elle devait sauver ces chants. » A la maison de Tunis, c’ était la communion parfaite. Son frère Jean El Mouhoub Amrouche, se mit de la partie. Au bout du compte sont nés Les Chants berbères de Kabylie, publiés en 1938. Cependant, la révélation est plus profonde. A Paris, elle monte son premier répertoire. Deux ans plus tard, en mai 1939, Taos, à l’insu de son père, se rend au Congrès de musique marocaine de Fès. Vêtue d’une robe blanche que l’on peut voir sur la couverture de la réédition de Rue des Tambourins, elle se produit devant un public émerveillé. Le directeur de la Casa Velasquez de Madrid est subjugué par la grâce de sa voix. Quelques conciliabules et, vite, la jeune Taos accepte de rejoindre, en compagnie de Maurice Legendre, la fameuse école sur les traces des chants de l’Alberca. En terre ibérique, elle rencontre le peintre André Bourdil avant de se marier avec lui. De retour à Alger, après un bref passage à Tunis, Taos s’est engagée à Radio-Algérie alors que son époux est pensionnaire de la Villa Abdeltif. Malade en1945, Taos regagne l’exil et c’est l’écrivain français Jean Giono qui va leur ouvrir les portes de sa résidence de Manosque, entre 1947 et 1949. Chemin faisant, elle est reconnue comme la spécialiste des chants berbères en France. C’est ainsi, qu’à partir de 1950, elle anime à Radio France-Culture des émissions et des entretiens avec des écrivains, au même titre que des chroniques littéraires en langue kabyle sur la RTF-ORTF. A l’occasion de deux concerts envoûtants en France, Paris n’a d’yeux que pour elle. Taos avait de la magie dans la voix. « Lorsque maman chantait, la chatte se mettait dans un état épouvantable : elle miaulait à la mort. Et puis, une voisine du rez-de—chaussée, quand maman chantait, faisait des crises d’hystérie… Cela pour dire la force étrange de son chant… », relate Laurance dans son témoignage. Devenue ambassadrice de la culture berbère, Taos tient de nombreux colloques à Orléans, Rabat et Florence. A l’invitation du président sénégalais Senghor en 1966, elle prend part au Festival des arts nègres. En 1967, elle remporte le Grand prix du Disque pour les chants berbères de Kabylie.
Jean Giono, l’ami bâillonneur
Taos Amrouche fut une romancière à la plume écorchée vive. Essentiellement d’ordre psychologique et intimistes, ses trois romans, Jacinthe noire (1947), Rue des Tambourins (1969), L’Amant imaginaire (1975) et Solitude ma mère (1995, à titre posthume), convergent dans les thématiques de l’exil, du déracinement, de la quête des origines, de la solitude et de l’amour insatisfait. En France, elle se lia d’amitié avec de nombreux écrivains de renom à l’image d’André Gide, François Mauriac et Jean Giono. L’intellectuel français André Breton qualifiait l’auteur de « Grain magique », un recueil de poésie, de reine Néfertiti dans une autre existence. Pour Taos, l’écriture n’aura été que souffrance. Elle écrivait pour comprendre et se faire comprendre, analysait Denise Brahimi dans son essai, Taos Amrouche romancière (1995). Sa fille se rappelle encore : « Ses livres ont été sa grande blessure. Je l’ai vue sangloter plusieurs fois à cause de cela, de son histoire avec Jean Giono, par exemple. Il l’a bâillonnait (…) Quand elle a écrit L’Amant imaginaire, il l’encourageait. Puis, quand il a su qu’elle le mettait en lecture et qu’il a reçu quelques coups de fil lui indiquant qu’il figurait dans l’ouvrage, il a paniqué et envoyé une lettre à tous les éditeurs, interdisant que l’on publie quoi que ce soit d’elle. Elle a été muselée comme cela pendant vingt ans… Il a fallu l’autorisation de Giono pour que sorte Rue des tambourins… ». Taos Amrouche est passée également par une période de froid avec son frère, Jean El Mouhoub, pour des « rivalités littéraires ». Et sa fille écrit : « Quant à Jacinthe noire, c’est son frère, Jean Amrouche, qui l’a « étranglé » chez l’éditeur Charlot… Jean adorait sa sœur, mais elle était son talon d’Achille. Il y avait entre eux presque une rivalité d’homme à homme. Elle l’a maudit une fois à la maison de la Radio… C’était terrible. Heureusement, vers la fin, ils se sont réconciliés et il est mort dans ses bras à elle. »
La disgrâce de trop
Le premier voyage en Algérie post-indépendance de Taos eut lieu en juin 1968 pour donner une conférence à la salle des Actes (souterrain des facultés, Alger) sur son frère Jean El Mouhoub, mort en avril 1962. Sur place, elle a entendu, par le biais d’une chanteuse kabyle qu’elle « chantait des chants des pères blancs ». Taos n’en croyait pas ses oreilles d’entendre autant de sornettes. « Cet antichristianisme primaire a blessé ma mère », atteste Laurence Bourdil-Amrouche dans son témoignage. La tenue de la 1re édition du Festival panafricain d’Alger aura été, par ailleurs, pour l’écrivaine et chanteuse, synonyme d’ostracisme et d’interdit scandaleux. Le président Houari Boumediene tenait un double discours. « Longtemps contraints de nous taire ou de parler la langue du colonisateur, c’était un devoir essentiel et premier que de retrouver nos langues nationales, les mots hérités de nos pères et appris dès l’enfance. », affirmait-t-il à l’ouverture de l’évènement. Pourtant, Taos s’est vu signifier par des officiels algériens une pure interdiction de chanter quand bien même elle était invitée d’honneur. Sa réponse indignée fuse vite. « Nos bijoux sont exposés, nos poèmes, contes et chansons sont répertoriés partout ailleurs à l’étranger. A quoi serviront alors vos lois et vos discours ? », avait-t-elle écrit dans une tribune parue dans le journal français Le Monde. Humble, elle accepta par ailleurs de chanter à l’invitation d’un groupe d’étudiants à la cité universitaire à Ben Aknoun. Pour son troisième voyage, arrêtée à l’aéroport, il aura fallu l’intervention de Rédha Malek, alors ambassadeur à Paris et d’Edmond Michelet. Après ç’a été fini, elle n’est jamais repartie (…) Le Maroc l’a accueillie plusieurs fois, pour qu’elle chante. Mais cela se faisait devant un public trié sur le volet. Un jour, Mohamed Arkoun m’a dit : Heureusement que Moulay Ahmed Alaoui a compris l’importance de ce que faisait votre mère ! Pourquoi fallait-il que ce soient les autres qui « comprennent » ? s’interroge, amère, sa fille dans son témoignage. Celle-ci continue de traîner une profonde blessure en raison de l’exclusion méprisable de sa mère de la reconnaissance officielle. Près d’un demi-siècle après l’indépendance, l’Algérie reste « intolérante » envers les Amrouche, en raison de leurs particularismes religieux et linguistiques. L’œuvre romanesque de Taos, au même titre que sa discographie, sont introuvables sur le marché national. Comme son frère et sa mère, elle n’est toujours pas célébrée dans les cercles officiels, encore moins dans les manuels scolaires. Pourtant, que de fois elle a chanté le pays perdu, la terre des ancêtres. Le devoir de mémoire implique une réparation urgente de ce long, terrible et inutile ostracisme.
Par Hocine Lamriben El Watan
Voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Taos_Amrouche
La diva Marie Louise Taos Amrouche
Published: